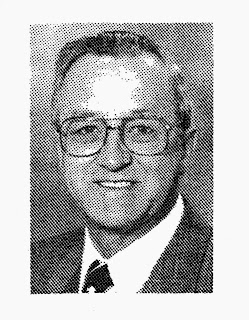Le chant du cygne Le cygne se tait toute sa vie pour bien chanter une seule fois.
Le chant du cygne Le cygne se tait toute sa vie pour bien chanter une seule fois.  Temps de légende
Temps de légende
Avec le recul des ans, mes quatre années au Juvénat de Chertsey (1954-58) prennent l’allure d’un temps de légende. Souvenirs échevelés qui, sous la coiffure du temps, se couvrent d’une toison d’or. Je vous livre quelques bribes de ces souvenirs, infimes parcelles, découpes d’un casse-tête dont l’assemblage formera un tableau qui trouvera peut-être sa place et ses titres dans le déroulement d’un itinéraire de vie.
À vol d’oiseau, le Juvénat de Saint-Théodore-de-Chertsey doit paraître comme un insolite amas de briques roses déposées en pleine nature, au bout du rang 5, sur un tapis d’épinettes noires, percé de quelques blancs bouleaux. Dans les faits, il a surgi comme une solution de dépannage suite à la pression d’une expansion galopante de la province de Montréal. Le Juvénat de Granby, qui logeait nos juvénistes, était devenu à l’étroit, et les projets de maison mère pour la province de Montréal n'avaient pas encore atteint l'étape d'une décision. On procéda donc rapidement à l'érection de ce bâtiment qui dans les plans devait servir ultérieurement de noviciat.
En septembre 1952, avant même qu'il soit terminé, il recevait ses premiers juvénistes. Dès l'ouverture, les juvénistes et le personnel se mirent à la tâche de ciseler cet amas et son décor pour en faire le rutilant joyau que nous connaîtrons. Mes quatre années d’enseignement dans cet établissement y contribueront très partiellement mais j’en garderai des souvenirs qui ont pris vite des allures de légende.
Équilibre et déséquilibre
Fin octobre, début novembre. Il fallait tout installer pour l'hiver.
Il fait frisquet en haut du poteau. À l’horizon, le soleil tire déjà ses couvertures pour la nuit. Je suis affublé des harnais d’un électricien, les éperons aux chevilles y compris. Je viens de gravir les trois quarts de ce tronc d’arbre qui servira cet l’hiver de poteau de suspension des luminaires, premier luxe que s’offre la patinoire du Juvénat.
Les juvénistes ont fait demi-couronne autour du poteau. Mon éperon gauche insuffisamment planté glisse sur l’écorce. Manœuvre qui déclenche des ouf ! de peur en provenance de la soixantaine de juvénistes témoins. Additionnés, ces ouf forment comme une espèce de coussin gonflable prêt à amortir l’impact d’une chute imminente.
Moi, je retiens mon souffle et ma peur. J’enlace le poteau de mes deux bras, alors que la ceinture de rétention en lâche prise flotte mollement dans les airs.

En bas, le silence murmure des invocations qu’il me semble entendre. « Mon Dieu, faites qu’il tienne! ». Tous les regards crispés convergent vers un seul point, mon éperon droit, unique ancrage de ma vie suspendue.
Quelques recommandations non signifiantes, mais chargées de sympathies à grand ampérage me soutiennent : « Tenez bon » (toujours le vouvoiement, même si on est en famille et à l'extrême éminence d'une catastrophe) « Lâchez pas! ». Soutenu par ce filet protecteur, je prends mon temps et reprends mon souffle.
Lentement, comme à tâtons dans les ténèbres, mon éperon droit réussit à creuser plus avant son ancrage, le genou se déplie, les muscles se tendent, les bras relâchent leur étreinte et la courroie de rétention reprend ses fonctions.
Comme sous la commande d’un réflexe automatique de survie et de haute précision, je plante prestement mon éperon gauche au centre du poteau, j’arque les reins, les mains libérées, je dégage, accroché à ma ceinture, le câble d’acier que je fixe à son crochet sur le poteau. Mission accomplie !
De la foule, comme un écho, une salve d’applaudissements grimpent les ondes et parviennent à mon rideau de scène. Cabotin, je me retourne, affichant l’un de mes plus beaux sourires cache-peur et je descends du poteau comme si de rien n’était.
L’horaire suspendu reprend les commandes et tous entrent à la queue-leu-leu, chacun dans sa stalle, comme les vaches de saint-Zéphirin, pour la traite de cinq heures. C’est l’étude du soir, debout devant leur pupitre, mes vingt-huit grands de neuvième année m’attendent, le temps du dételage, pour que je préside la prière, ce que je fais avec le sérieux d’un fonctionnaire qui n’a rien fait d’autre de toute sa vie.
C’était ainsi tous les jours au Juvénat de Chertsey. Le quotidien chevauchait l’insolite, l’imprévu assaisonnait le banal et l’extraordinaire prenait les livrées du normal. Des œuvres de titans étaient accomplies par nous, nains d’une gigantesque entreprise, celle de faire de cette montagne de roches un chaleureux nid de vie où s'ébattront des oisillons en pleine croissance.
De pareils émois, j’en connus plusieurs, à la limite de la tension des points de rupture.
Rescapé d’une calvette
La cour avait été aplanie depuis un an déjà par frère Paul-Étienne fièrement mon té sur son puissant bélier mécanique. L’un des tuyaux (calvette) qui drainaient les eaux venues de la montagne étant bloqué, frère Maître avait décidé d’y envoyer en prospection le plus petit des juvénistes, C. Leblanc. Muni d’une lampe de poche et traînant un câble de chanvre d’un demi-pouce de diamètre, son fil d’Ariane et notre précaution, il se glissait dans le noir tuyau de béton par saccades que nous renvoyaient les échos de sa voix et les soubresauts du cordon, seul lien vital qui le rattachait à nous.
té sur son puissant bélier mécanique. L’un des tuyaux (calvette) qui drainaient les eaux venues de la montagne étant bloqué, frère Maître avait décidé d’y envoyer en prospection le plus petit des juvénistes, C. Leblanc. Muni d’une lampe de poche et traînant un câble de chanvre d’un demi-pouce de diamètre, son fil d’Ariane et notre précaution, il se glissait dans le noir tuyau de béton par saccades que nous renvoyaient les échos de sa voix et les soubresauts du cordon, seul lien vital qui le rattachait à nous.
Sur la pente où devait s’écouler l’eau du drain, deux lignées de têtes et de corps tendus s’étaient formées marquant par leur silence la densité de l’heure. Les vingt paires d’yeux témoins s’ouvraient au maximum, telles des lentilles de caméra. comme pour absorber l’obscurité qui s’échappait du tuyau. Parfois, une tête se tournait comme pour ne pas être témoin de la vision d’une horreur appréhendée.
À chaque secousse de la corde, nous semblait-il, l’écho de la voix se faisait plus faible. Presque rien, puis plus rien… À l’extérieur, les vocalises d’appel s’élèvent vite au niveau de la panique et deviennent des cris d’alarme. On réussit à faire taire la galerie, on tend l’oreille, rien, toujours rien, l’instant du silence infini, celui de l’avant big-bang. Plus de modulations non plus de la corde témoin, rien que le silence de l’immobilité.
Soudain, un déclic, comme celui du coup de feu qui rompt la tension extrême entre deux armées qui s’affrontent. On tire fébrilement sur la corde, on court en tous sens à la recherche de ce qui pourrait tomber sous la main, cran d’arrêt d’une implacable machine de mort, trousse de premiers soins et que sais-je encore…?
La corde aux dix mains nerveuses, travaille comme forceps dans les entrailles de la terre à la recherche d’une vie en train de se perdre. Le temps a du plomb dans l’aile. Après des fractions de seconde qui ont l’éternité pour mesure, C. Leblanc apparaît les pieds devant, les genoux amochés, la chemise dégoulinante de boue, le visage d’une blancheur à faire peur. Un Lazare qui sort d’un tombeau de nuit. Il apparaît, paré du timide sourire de celui qui s’excuse d’avoir raté son examen.
Comme si de rien n’était, notre raton-laveur va prendre une bonne douche tiède et se retrouve avec les autres à l’étude de cinq heures.
Moi, n’étant pas acteur mais observateur, il me fallut plus de temps pour me décoincer de mes jugements qui s’appuyaient fébrilement sur de vagues principes de sécurité. Je passai au bureau du frère Directeur et lui fit part de mon énervement. Je ne voulais plus jamais risquer de frôler une telle catastrophe. Et il avait la responsabilité d’y voir sans tarder.
Une heure plus tard, l’étude sautée, je me retrouvai au réfectoire, à la table des professeurs juchée sur une tribune, face au frère Maître, dos aux juvénistes qui placotaient comme à l’accoutumée. Un silence de politesse guida nos conversations. On ne se parla jamais de ce moment critique ni des sentiments qui m'animaient ni de l'attitude du jeune explorateur, excepté hier, cinquante-quatre ans après l’événement. Frère Marie-Albert s’en souvenait comme un fait parmi d’autres mais qui, dans sa mémoire n’avait pas le caractère dramatique de mes propres souvenirs.
C’était un temps où la générosité prévalait sur la sécurité mais pas nécessairement sur le sens des responsabilités.
La vie de famille reprit dans la sérénité avec les tonalités d’une jovialité coutumière. Je n’ai même jamais su ce qui avait bloqué le fameux drain, ni comment on l’avait débloqué.
Une espèce de radeau de la Méduse
Toute plage de tout lac des Laurentides se devait de faire flotter non loin du rivage son radeau généralement monté sur des barils. Pour pallier l’instabilité des radeaux et échapper aux ennuis de leur remisage, frère Réal et moi avions imaginé une structure de métal à pattes coulissantes qui, appuyées au fond inégal du lac, maintiendrait le radeau en place et lui permettrait de demeurer constamment à niveau.
La structure de soutien étant faite d’arches de tuyaux soudés plus solides que le pont de Québec pesait très lourd. Il fallut plusieurs paires de bras et quelques arrêts d’essoufflements pour la descendre jusqu’au lac. Il fallait aussi, sans point d’appui, parvenir à la fixer à environ cinquante pieds de la rive, les pattes reposant sur un fond fangeux d’une profondeur variable.
En apprenti-ingénieur d’une virtuelle école d’Archimède, j’imaginai un système de flottaison qui permettrait de pousser la structure métallique au large, d’y descendre les pattes à la profondeur requise, de les y bloquer et de retirer les flotteurs, de simples barils de pétrole vides.
Quatre juvénistes des plus forts et des meilleurs nageurs étaient postés au quatre coins et devaient, avec des câbles, manœuvrer la descente des pattes, plonger pour fixer sous chacune d’elles une base plus large qui maintiendrait le radeau à niveau et en équilibre. Bref, un système fort compliqué pour une opération très simple. Et il a suffi qu’un baril qui cherchait une meilleure stabilité glisse sur le côté pour que tout se déséquilibre et se ramasse au fond, cul par-dessus tête, en y emportant moussaillons et capitaine.
À cinq heures, je suis remonté au Juvénat tout dégoulinant de honte. Mon passage déclenchait des sourires ronds comme des soleils sans parasols.
Ce radeau fut le lendemain remis en équilibre. Muni d’une tour à plongeon et d’échelles aux lignes « design », il complétait l’aménagement de cette plage privée et ensablée qu’on avait à force de bras et d’astuces tirée du marécage qui avait jusqu’alors régné à ce bout du lac. On en tirait une gloire de démiurges.
Berger insolite dans la crèche
Pour terminer cette série par un événement un peu loufoque, voici un souvenir que j’avais rapidement chassé de ma mémoire sélective mais qu’on m’a rappelé si souvent qu’il mérite un instant de survie.
Nous sommes le 24 décembre, vers 23h00, juste une demi-heure avant que j’aille claironner l’Ametur Cor Jesu de réveil des juvénistes pour la messe de minuit. J’étais alors aussi le sacristain de la maison. À ce titre j’avais monté à la chapelle une crèche avec des toiles badigeonnées de restants de peinture, gauches imitations des rochers de Bethléem.
Je n’étais pas satisfait de l’éclairage. Tâchant d’y remédier, je perdis l’équilibre et tombai sur l’un des bergers de plâtre qui, en attente du divin Enfant, y faisait ses dévotions. Sous le choc, il éclata en mille miettes. Des confrères alertés par le bruit de la chute accoururent et me trouvèrent étendu dans la crèche en train de ramasser à la fois des morceaux de berger et mes esprits. Les fous rires fusèrent et la légende née de cette hécatombe grandit au point de me donner des intentions de maraudage auprès du syndicat des bergers de Bethléem.
Un autre que moi alla sonner le réveil au dortoir et la messe de minuit put commencer à minuit tapant « comme si de rien n’était » avec le tonitruant chant du «Minuit, chrétiens » !
Après six ans de travaux herculéens, le Juvénat de Chertsey aurait pu être classé, comme l’avait été le Mont-Sacré-Cœur, dans la catégorie des plus beaux sites du Québec. On vantait aussi le caractère fonctionnel de son organisation. Plusieurs frères des autres provinces émergentes sont venus s’en inspirer. Perdu au fond des bois, on avait craint qu’il convînt peu à des jeunes en pleine croissance et débordants de dynamisme. Son isolement, au lieu de paralyser les énergies et de propager les ennuis, contribua comme nulle part ailleurs au développement d’un incomparable esprit de famille.
Il y avait tant à faire, on se sentait si bien chez soi qu'on n'avait pas le temps de s'ennuyer. Une nouvelle équipe de profs prenait la relève pendant les vacances et mettait sur pied un grand nombre d'activités d'artisanat et d'initiation à différents arts: fabrique d'abat-jour en bois, finement découpés à la scie sauteuse, collection de papillons, herborisation, fabrique de bijoux etc. Les traditions de la ruche du Mont-Sacré-Coeur s'y étaient transplantées et y prospéraient.
Le Juvénat de Chertsey, ce joyau de briques roses gauchement cimenté à une nature sauvage, portera longtemps la marque et toujours le souvenir de ses occupants, une famille d’apprentis sorciers qui l'ont marqué de leur génie et de leurs audaces.
Une équipe du tonnerre
Ce qui m’a rendu le Juvénat  de Chertsey si attachant, je crois, c’est qu’il fut un temps de création. Un de ces temps qui mobilise toutes les énergies disponibles et qui met en branle tous les talents manifestes ou cachés. La routine crée des robots qui s’entrechoquent, la création crée des génies qui se conjuguent.
de Chertsey si attachant, je crois, c’est qu’il fut un temps de création. Un de ces temps qui mobilise toutes les énergies disponibles et qui met en branle tous les talents manifestes ou cachés. La routine crée des robots qui s’entrechoquent, la création crée des génies qui se conjuguent.
Laissez-moi vous présenter mes principaux coups de cœur pour les génies qui ont forgé le Juvénat au dehors comme au dedans.
Frère Grégoire
En hiver, le samedi soir, assis au bout du corridor des classes, la pipe à la bouche, le nerveux frère Grégoire suit la partie de hockey qui oppose le Village au Juvénat. La fenêtre, c’est son écran (la  télévision n’avait pas encore pénétré dans nos demeures). Le bon frère entre en fonction chaque fois qu’il y a hockey. Il y tient à la fois le rôle de commentateur, d'arbitre et de coach de la joute qui se déroule devant lui. Il tempête, frappe sur le rebord de la fenêtre, interpelle les joueurs sans que ceux-ci puissent l’entendre, jusqu’à en oublier de fumer sa pipe. Le match terminé, il fait aux joueurs du Juvénat, des recommandations et des commentaires dignes de « La ligue du vieux poêle » de Charley Mayer ou de Jean-Maurice Baillly.
télévision n’avait pas encore pénétré dans nos demeures). Le bon frère entre en fonction chaque fois qu’il y a hockey. Il y tient à la fois le rôle de commentateur, d'arbitre et de coach de la joute qui se déroule devant lui. Il tempête, frappe sur le rebord de la fenêtre, interpelle les joueurs sans que ceux-ci puissent l’entendre, jusqu’à en oublier de fumer sa pipe. Le match terminé, il fait aux joueurs du Juvénat, des recommandations et des commentaires dignes de « La ligue du vieux poêle » de Charley Mayer ou de Jean-Maurice Baillly.
Le même frère Grégoire, alors sûrement septuagénaire, avait travaillé du matin au soir à clouer des bardeaux de cèdre sur le toit et les murs des camps du centre d’études des frères en bas de la côte.
Petit, nerveux, il semblait de prime abord peu sociable et ne prenait jamais l’initiative de la conversation. Il avait enseigné déjà mais personne ne s’en souvenait.
Au Juvénat, il travaillait en second à la menuiserie avec le frère Georges-André, un jeune encore dans la vingtaine, à compléter les mobiliers de rangement et l’ameublement de la maison. Il s’occupait également de son entretien.
Sa détente en hiver, à part le hockey, c’était sa carabine, un petite .22 qu’il portait à l’épaule, chargée d’une seule balle. Il partait vers 13h00, empruntait les sentiers qu'il s’était battus dans la neige et revenait vers 16h00. Immanquablement, un lièvre pendait au bout de sa carabine. Son défi: une balle, un lièvre. Je ne l’ai jamais vu revenir bredouille. Il entrera dans la légende des chasseurs de petit gibier.
À la célébration de ses noces d’or de profession en 1955, il se révéla un orateur raffiné maniant avec grâce les belles tournures et usant de bonnes manières. Personne ne l’avait jamais imaginé ainsi.
Son curriculum de vie, alors sorti des boules à mites, révéla les nombreuses charges qu’il avait assumées dans sa vie sans qu’on le soupçonne, tellement sa taille était petite et grande son humilité: professeur auprès des petits et des grands, en Nouvelle-Angleterre comme au Québec, en français comme en anglais, maître-chantre, metteur en scène et factotum, etc. Un petit pot aux meilleures confitures.
Frère Paul-Étienne
Le frère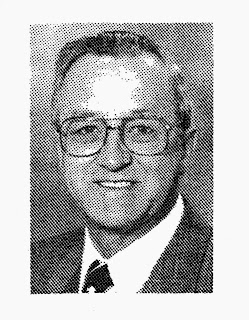 Paul-Étienne, un Lajoie de St-Didace, (ils étaient trois frères en communauté dont le frère Réal, professeur au Juvénat). Il souffrait de diabète. Il fut d’abord employé à Granby pendant plusieurs années à la lingerie à classer les vêtements et à les rapiécer.
Paul-Étienne, un Lajoie de St-Didace, (ils étaient trois frères en communauté dont le frère Réal, professeur au Juvénat). Il souffrait de diabète. Il fut d’abord employé à Granby pendant plusieurs années à la lingerie à classer les vêtements et à les rapiécer.
Il vint à Chertsey avec les juvénistes en 1952 comme rivé aux manettes du bélier mécanique que le frère Rosaire avait acheté en vue du terrassement de la propriété de la maison mère. Il y fit œuvre de titan. Gruger la montagne de roches comme un patient rongeur, la transformer en jardins fertiles, en champs de balle ou en courts de tennis, déplacer des rochers gros comme Sisyphe n’en aura jamais vu, calculer les chemins de l’eau, contrer la boue gluante des alentours du lac etc., voilà ce que fit le frère Paul-Étienne pendant les trois années au cours desquelles il vécut à Chertsey.
Frère Fortunat
Le frère Fortuna t, c’était le sourire aux cuisines. Il y faisait tout et de tout avec une habileté déconcertante et l’aisance des grands maîtres. À 14h00, son job était terminé. Il montait à sa chambre ou allait prendre, seul, une marche dans la nature. Il reprenait le boulot vers 16h00 et tout était toujours prêt à temps et cuit à point pour chacun des repas. Les jours de fête, il nous réservait des menus spéciaux. Avec la grâce du sourire, il parait aux imprévus causés par des visiteurs retardataires ou par des pannes du système électrique. Toute randonnée comprenait des lunchs qu’il préparait avec soin et minutie.
t, c’était le sourire aux cuisines. Il y faisait tout et de tout avec une habileté déconcertante et l’aisance des grands maîtres. À 14h00, son job était terminé. Il montait à sa chambre ou allait prendre, seul, une marche dans la nature. Il reprenait le boulot vers 16h00 et tout était toujours prêt à temps et cuit à point pour chacun des repas. Les jours de fête, il nous réservait des menus spéciaux. Avec la grâce du sourire, il parait aux imprévus causés par des visiteurs retardataires ou par des pannes du système électrique. Toute randonnée comprenait des lunchs qu’il préparait avec soin et minutie.
En communauté, souvent les cuisiniers, après un mois ou deux d’opération, devenaient la cible de nombreuses critiques. Il est difficile de satisfaire à la fois le ventre et son palais. Mais je n’ai jamais entendu de critiques à l’endroit du frère Fortunat ni à l’endroit de sa cuisine.
Frère Anatole
Le frère Anatole, dir., le même qui fut mon premier directeur à St-Victor, n’avait pas, à Chertsey, la responsabilité de l’enseignement. Il avait surtout celles de l’auto et de l’approvisionnement de la maison. C’est l’image d’un paternel enjoué et toujours heureux de participer à nos fêtes que j’ai surtout retenue de lui.
responsabilité de l’enseignement. Il avait surtout celles de l’auto et de l’approvisionnement de la maison. C’est l’image d’un paternel enjoué et toujours heureux de participer à nos fêtes que j’ai surtout retenue de lui.
Tous les samedis, lui ou le frère Armand devait me conduire à l’université et attendre, à l’école Meilleur, que je revienne de mes cours vers 16h00. Il lui arrivait parfois de bougonner devant cette tâche qu’il devait remplir par tous les temps. « C’est simple, lui dis-je un jour, vous n’avez qu’à me laisser prendre mon permis de conduire et je ne vous ennuierai plus avec cette besogne ». Le privilège de conduire l’auto était tellement sacré et réservé à si peu d’élus que ma remarque eut le don de le guérir de toute envie de jérémiades futures.
Pour occuper les soirées du samedi soir, on faisait venir de l’ONF ou des ambassades de divers pays des documentaires que l’on projetait aux juvénistes. Je sentais confusément que le frère Directeur était mal à l’aise devant certaines de ces projections. Une fois que je lui demandais de rapporter les films ainsi retenus, il me fit une remarque qui m’en dit plus long que tout discours sur son malaise. « Ah! Vos films de fesses françaises? »
Plus tard, quand la télévision est entrée dans nos murs, il fallait obtenir l’autorisation pour en faire usage après 21h00. Un certain jeudi, on projetait à 23h00 «Le malentendu» d’Albert Camus. Camus m’intéressait. J’avais lu « La peste » et je voulais voir « Le malentendu ». Ce fut pour lui presqu’un martyre de me donner l’autorisation de le visionner. Il vint par deux fois au cours de l’émission constater « de visu » ce qui en était. Je compris que son mal venait de ce qu’il était bien de son époque. Homme magnanime dans sa papauté (on l’appelait Ti-pape), dix ans plus tard il sera mon adjoint au recrutement. Il respectera alors religieusement mes directives.
Frère Clarence
Frère Clarence était un franco-américain, nommé Salois. Au Juvénat il était professeur d’anglais, et s’occupait de l’in firmerie. Homme jovial, au rire sonore, il gagnait facilement la sympathie de tous.
firmerie. Homme jovial, au rire sonore, il gagnait facilement la sympathie de tous.
Et quelle patience ! Il acceptait tous les soirs de faire une promenade avec moi et tout le temps que durait la randonnée, la consigne était de ne parler qu’en anglais. Il avait la patience et toujours la bonne humeur de me reprendre et de corriger mes baragouinages. Comme il souffrait de surdité, le ton de nos voix s’élevait instinctivement au point qu’on pouvait, du Juvénat, suivre nos conversations qui de ce fait sont entrées dans les légendes rattachées à son nom et peut-être aussi au mien.
Après les vacances des fêtes de Noël et du Jour de l’An, en 1956 je crois, une épidémie de grippe couvrit de sa contagion tout le Juvénat. Frère Clarence et moi-même nous restions les seuls à demeurer debout et intacts. J’étais son commis pour distribuer dans le dortoir et aux chambres des frères médicaments et bouillons. J’ai pu apprécier son courage et sa grande générosité.
En 1943, il fit partie du premier groupe de frères qui fondèrent la mission d’Haïti. Il dut en revenir quelques années plus tard à cause de difficultés mal connues. Sa ténacité de Breton obtint qu’il y retournât après 1960 pour plusieurs années. Il occupait alors ses loisirs à peindre les chaudes couleurs d’Haïti, de son enfance et de son caractère toujours épanoui en un large sourire.
Frère Marie-Albert
Frère Marie-Albert  ! Quelle énergie ! Quelle générosité de cœur et d’esprit ! À Maniwaki où il a passé plusieurs années avant d’être nommé au Juvénat de Granby, il était reconnu comme un professeur enthousiaste, débordant de talents et d’initiatives.
! Quelle énergie ! Quelle générosité de cœur et d’esprit ! À Maniwaki où il a passé plusieurs années avant d’être nommé au Juvénat de Granby, il était reconnu comme un professeur enthousiaste, débordant de talents et d’initiatives.
L’image du Juvénat, cette terre de roches transformée en paradis est associée à son nom et à son énergie. Il exerçait sur les juvénistes un ascendant hors de l’ordinaire et avait le don de dégeler les plus timides pour en faire des collaborateurs inconditionnels à tous les travaux.
Sa consécration à ses juvénistes vingt-quatre heures par jour l’écartait du corps des professeurs qui étaient facilement et trop facilement critiques à son endroit. Ce dut être très pénible pour lui de supporter en silence le poids de ces critiques ou en sa présence, les silences mitigés de nos conversations. La malice et la jalousie se manifestent souvent cachées sous les meilleures intentions.
En 1962, après dix ans, il n'y avait comme plus rien à faire au Juvénat. Frère Marie-Albert s'offrit comme missionnaire en Côte d'Ivoire. Il y bâtit une oeuvre gigantesque. Il était de la race des bâtisseurs.
À 92 ans, il demeure aujourd’hui le seul survivant des frères qui ont œuvré au Juvénat de Chertsey. Il se rend utile au magasin scolaire de l’Externat Sacré-Cœur, tâche qu’il accomplit depuis dix ans déjà. Conjointement avec ce boulot quotidien et avec le même sourire taquin, il poursuit l’œuvre de l’évangélisation des pages web qu’il inonde de ses belles images et de ses bonnes pensées. Pour le garder en vie, il faudrait lui trouver un autre défi que seuls les géants peuvent relever.
Frère Georges-André
Aircraft Flash! À St-Théodore, nous étions sur la ligne de la protection aérienne du Nord canadien (NORAD) à partir de la base établie à La Macaza. Le frère Georges-André était chargé de noter les avions qui passaient au-dessus de nos têtes et de référer les coordonnées de ses observations à un centre de coordination de la Défense nationale. Il prenait son rôle très au sérieux.
Le jour de son anniversaire, afin de l’éloigner lors des préparatifs, nous avions simulé un appel de surveillance spéciale qui l’immobilisa sur le toit du Juvénat pendant deux bonnes heures. Et ce n’est qu’au moment de lui remettre un diplôme et une lettre de reconnaissance émanant de la Canadian Royal Air Force que nous lui avons révélé la supercherie de la mission spéciale qu'il avait reçue par notre entremise.
On ne pouvait avoir un homme de service plus dévoué que le frère Georges-André. Je crois qu’il a battu tous les records de longévité au Juvénat de St-Théodore. Il y était venu avec l’ouverture du chantier du centre d’études en 1949 et y demeura jusqu’à sa fermeture en 1990.
Frère André-Jean
Frère André-Jean était l’homme aux talents polyvalents à rendre envieux tous ceux qui le côtoyaie nt. Mais sa sympathie si chaleureuse avait le don de dissoudre tout germe de malentendu ou d’inimitié.
nt. Mais sa sympathie si chaleureuse avait le don de dissoudre tout germe de malentendu ou d’inimitié.
Bon pédagogue au rire conquérant, il se gagnait facilement la confiance de tous ses élèves. Il enseignait les Éléments latins. Méthodique, il rendait tout facile à comprendre et à apprendre. Maître de chorale, il dirigeait les chants avec élégance et doigté. Quand venait le temps des décorations, il dessinait tout et en couleurs avec une facilité déconcertante. Il excellait surtout comme metteur en scène. À chaque fête, il montait une saynète, une comédie musicale ou des récitations qui avaient toujours le don de plaire et de charmer.
De lui je garde aussi le souvenir de sa lutte implacable de tous les matins contre le sommeil. Né avant terme, il disait qu’il avait manqué de sommeil. Il avait beau se tenir debout ou à genoux pendant la méditation, le sommeil avait toujours raison de sa tête qui, jusqu’au déjeuner, oscillait dangereusement. Mais pour lui, ce ne fut jamais une raison de manquer à ses devoirs de présence.
Il fut transféré au Postulat de Rosemère ou il fut titulaire des classes de latin pendant plusieurs années. Il prit la direction du Collège canado-haïtien à Port-au-Prince, puis, revint à l’Externat de Rosemère où il finit ses jours dans la sérénité qui avait été la marque de sa vie pourtant très active. Il fut emporté par un cancer qu’il combattit courageusement pendant plus de deux ans.
Frère Armand qu'on appelait "la petite musique". est aussi digne de mention. Il assurait à l'orgue les accompagnements à tous les offices liturgiques. Il rendait le même service à la salle de récréation à toutes les fêtes qui réunissaient la communauté. Tous les petits travaux d'agencement ou de réparation qui demandaient de la finesse et du doigté lui étaient confiés. Il portait les séquelles d'une tuberculose qui, lorsqu'il était jeune, avait failli lui coûter la vie.
Frère Réal
Frère Réal était de ma race, un peu gauche en tout. Il était plutôt intellectuel et je me plaisais à deviser avec lui sur toutes sortes de sujets.
Il avait acquis une profonde connaissance des lettres latines et de la civilisation romaine. Directeur des études, il excellait dans l’attention apportée à tout document et à sa classification. À l’ouverture de la maison mère à Rosemère, en 1957, il fut transféré au Scolasticat.
maison mère à Rosemère, en 1957, il fut transféré au Scolasticat.
En 1967, il adhéra à fond aux thèses de renouvellement de la Pastorale enclenchée par Vatican II. Il s’engagea dans un mouvement charismatique, fut ordonné prêtre et, à la fermeture du Juvénat de Chertsey, il fonda la maison Jésus-Enseignant, un centre de réflexion et de ressourcement spirituel qu’il anima pendant près de quinze ans.
Il décéda des suites d’un accident d’auto et je ne pus même pas assister à ses funérailles. Précédemment, il m'avait conduit au chevet du frère André-Jean, qui, en phase terminale, luttait avec courage et sérénité contre le cancer. Le départ de ces frères fut pour moi un deuil qui m’a révélé combien étaient vivants et sensibles les liens d’amitié que nous avions développés dans nos engagements communs au Juvénat de St-Théodore.
Mystère et profondeur des êtres, des amours et des destins d'une vie
Des dix-sept frères avec qui j’ai vécu au Juvénat de 1954 à 1958, il ne reste qu’un seul survivant en communauté, soit le frère Marie-Albert. Déjà douze d’entre eux reposent au cimetière de la communauté et cinq l’ont quittée comme moi pendant les années de la débâcle. De toutes mes années d’enseignement sous l’ancien régime, c’est le groupe de frères qui a atteint le plus haut taux de persévérance soit 72.2%.
Enseigner au Juvénat, c’était du gâteau
Le Juvénat offrait alors le cours secondaire scientifique (8e, 9e, 10e) et le cours classique comprenant les Éléments latins, la Syntaxe, la Méthode et la Versification. J’y enseignai d’abord la 9e année (1954-55) puis la dixième (1955-56) et la Syntaxe pendant les deux dernières années.
Enseigner au Juvénat c’était du gâteau. Tout ce qu’un professeur pouvait souhaiter et même davantage était assuré en permanence. Il y avait des heures d’études régulières. Un nombre d’étudiants réduit (classes de quinze à vingt-cinq étudiants au Juvénat de Chertsey). On avait devant soi des jeunes intelligents, avides de savoir et rompus à la discipline de l’étude. La crème des écoles de la province de Québec.
Aucun syndicat ne pourra jamais négocier des conditions de travail aussi avantageuses.
Quelques miettes de ce gâteau
Je suis au laboratoire de physique avec mes élèves de dixième année , une vingtaine de juvénistes qui, au mois de février, seront tous postulants. Depuis une heure, nous avons un plaisir fou à nous amuser avec un petit siège grossièrement façonné d’un bout de fil de fer dont nous varions les charges et les points d’appui. Nous étudions en nous amusant les lois de la gravité et les conditions d’équilibre.
, une vingtaine de juvénistes qui, au mois de février, seront tous postulants. Depuis une heure, nous avons un plaisir fou à nous amuser avec un petit siège grossièrement façonné d’un bout de fil de fer dont nous varions les charges et les points d’appui. Nous étudions en nous amusant les lois de la gravité et les conditions d’équilibre.
Un autre jour la classe de physique occupait tout l’escalier du sous-sol au dortoir. Nous répétions l’expérience du tonneau de Pascal qui permit de découvrir les lois et les mesures de la pression atmosphérique. Le laboratoire était petit et peu équipé. Tout le juvénat pouvait servir de labo sans que personne ne passât de remarques.
Chaque classe avait son blason, son cri de ralliement et son chant de groupe. Il y avait infailliblement deux périodes d’étude par jour. Pendant ces temps  d’étude, régnait un silence à entendre voler une mouche. Et j’ai vraiment appris mon latin en l’enseignant en syntaxe.
d’étude, régnait un silence à entendre voler une mouche. Et j’ai vraiment appris mon latin en l’enseignant en syntaxe.
Les lundis matin nous faisions le serment au drapeau et chantions avec une ferveur de patriotes l’Ô Canada suivi du chant de classe.
Tous les mois, il y avait lecture des notes (chiffrées) et des tableaux d’honneur qui paraissaient même dans La Voix du Mont-Sacré-Cœur. On organisait de temps en temps des compétitions qui portaient sur les dates mémorables de l’Histoire du Canada, sur les pays du monde et leur capitale, sur les règles de syntaxe les plus abracadabrantes et sur les orthographes les plus bizarres que peut afficher la langue française. Tous s’engageaient dans ces joutes intellectuelles avec une ardeur digne des plus valeureux Spartiates.
Enseigner au Juvénat c’était du gâteau même si le poste exigeait une disponibilité de plus de quarante heures semaine.
Des vacances sous la rigueur du thomisme
En août 1954, je passai mes derniers examens de philosophie pour le baccalauréat es arts. Étudier la philosophie sans professeur c’est un peu comme être en conversation avec soi-même. Le manuel de base était un Précis de philosophie d'Henri Grenier. Pour avoir une certaine assurance de passer à l’examen, il fallait pratiquement l'apprendre par cœur.
Cette pensée fondamentalement thomiste m’avait donné le goût de réflexions plus approfondies. Je choisis donc après l’obtention du baccalauréat de pousser mes études en philosophie et je m’inscrivis aux vacances de 1955-56-57 aux cours donnés par l’université Laval à Québec en vue du baccalauréat en philosophie. Une cinquantaine de religieux et de religieuses et quelques laïcs suivaient ces cours. Nous étions six frères du Sacré-Cœur de différentes provinces communautaires tous logés à la résidence de l’école St-Pascal de Québec. Tous les matins, un taxi à huit places, presque une limousine, nous amenait Chemin Ste-Foy au pavillon de philosophie de l’université Laval.
Monsieur Charles de Koninck, père de douze enfants, dont Jean-Marie de Koninck que nous connaissons, y enseignait la métaphysique.
Il se promenait de long en large devant la classe, devisant sur le hasard dont il illustrait le concept en employant des images qui le rendaient visible et tangible. Finalement, je n’ai jamais su si le hasard existe ou s’il n’existe pas. Notre illustre professeur pensait-il qu’un esprit puissant aurait pu en faisant la conjonction de tous les déterminismes prédire qu’une abeille viendrait à onze heures et vingt-deux minutes se poser sur la rose de la plate-bande de l’Institut qu’un bon frère de St-Vincent-de-Paul venait d’arroser?
Si je n’ai jamais su ce qu’il pensait vraiment, avec ce prof que je ne peux oublier, j’ai appris qu’on pouvait, comme des enfants, jouer avec les concepts, les tourner d’un côté ou de l’autre, pourvu qu’on puisse assumer comme des adultes les conséquences rationnelles de nos pensées et qu’on apprenne à vivre et à penser avec la relativité que notre siècle posait déjà comme balise des temps nouveaux.
Une image d’Émile Simard, titulaire du cours La Nature et la portée de la méthode scientifique, me servit longtemps de clé pour résoudre les contradictions apparentes entre les vérités de la foi et celles de la science. Son volume était illustré par un pêcheur confortablement assis dans sa chaloupe et qui, retirant son filet de l’eau, disait : « Ce que mon filet ne prend pas n’est pas poisson » Remplacez filet par la raison ou la science et vous comprendrez l’impuissance de la raison à saisir tout le réel. Ces énoncés et les réflexions qui les accompagnaient donnaient plus de mordant aux doutes que j’essayais de refouler sur l’existence de Dieu, son unicité et sur les fondements des religions qui essaient de nous le démontrer.
longtemps de clé pour résoudre les contradictions apparentes entre les vérités de la foi et celles de la science. Son volume était illustré par un pêcheur confortablement assis dans sa chaloupe et qui, retirant son filet de l’eau, disait : « Ce que mon filet ne prend pas n’est pas poisson » Remplacez filet par la raison ou la science et vous comprendrez l’impuissance de la raison à saisir tout le réel. Ces énoncés et les réflexions qui les accompagnaient donnaient plus de mordant aux doutes que j’essayais de refouler sur l’existence de Dieu, son unicité et sur les fondements des religions qui essaient de nous le démontrer.
Ces vacances à l’étude de la philosophie m’ont aussi permis de connaître des confrères éblouissants par leur intelligence et admirables par leur engagement à la cause de l’éducation et à l’Institut. Trois d’entre eux devinrent par la suite supérieurs provinciaux et deux oeuvrèrent dans les missions qu’ils fondèrent en Nouvelle-Calédonie et en Australie.
Le chant du cygne
"Triés sur le volet". C’était l’expression qu’un supérieur utilisait fréquemment pour vanter le personnel des maisons de formation.
meta name="ProgId" content="Word.Document">
meta name="ProgId" content="Word.Document">link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5CJutras%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"> C’est dire combien grande avait été ma surprise lorsque, le 15 août 1954, j’avais entendu prononcer mon nom, le quatrième de la liste du personnel du Juvénat de Chertsey, après les frères Marie-Albert, Jean-Charles et Réal, Je crus d’abord qu’il s’agissait de mon presque homonyme, le frère Florien mais, je dus me rendre à l’évidence. Je me levai avec hésitation et j’entendis comme un écrasant défi les applaudissements qui soulignèrent ma nomination. À prime abord, cette tâche m’écrasait et me semblait tellement au-delà de mes compétences.
Un certain malaise venait aussi du fait que Clément, mon frère, était juvéniste à Chertsey l’année où j’y ai été nommé. Je me souviens que le premier jour de mon arrivée, il vint me trouver au dortoir où j’aménageais mes pénates. Spontané, il me sauta dans les bras. Son accueil me fit plaisir mais j’ai cru de mon devoir de l’avertir qu’au Juvénat, j’étais un professeur comme les autres et qu’il n’y aurait pas de passe-droit parce qu’il était mon frère.
Le reniement de saint Pierre dut aussi être fondé sur de bonnes justifications
Quand j’ai quitté Chertsey en 1958, de grandes portes s’ouvraient devant moi. Celle d’un ailleurs fascinant par ses mystères et sa renommée, celles du savoir revu à sa source, celles d’un chez-soi qui grandissait à la mesure de l’univers. L’ouverture de Jesus Magister, une heureuse initiative dans la continuité, d’abord, des pratiques de perfectionnement des frères en sciences religieuses et aussi dans la foulée du rapprochement des communautés vouées à l’éducation de la jeunesse.
Le Juvénat de Chertsey reproduisait les patterns de la plupart des maisons de formation religieuse de ce temps. Des prodiges d’équilibre et de bon sens, fruits d’une longue maturation et d’habiles conciliations avec des impératifs de tous ordres.
Après cinquante-deux ans, revoyant en flash-back les épisodes qui ont marqué mes quatre ans au Juvénat de Chertsey, je me défais difficilement d’une certaine nostalgie, ce sentiment bizarre qui enveloppe d’un suaire une époque, des lieux familiers, des êtres chers, des sentiers tracés, des habitudes de va-de-soi, des vocabulaires reconnus, des temps programmés, des futurs apprivoisés…, enfin tout ce qui touche la vie de tous les jours, tout ce qui caractérise une communauté et une façon d’être et la distingue des autres.
Une nostalgie tenace mais impuissante à l’égard de tout ce qui est devenu désuet ou qui est en voie de disparition.
Cette époque au sommet de sa performance était déjà passée. Il n’y aurait pas pour elle de nouvelles commandes. D’autres coureurs s’amenaient sur la piste. Ses sources d’énergie taries, elle devra se résigner à passer le flambeau.
Ce temps m’apparaît alors comme paré de costumes qu’aucune décennie ne portera plus, des costumes de répétition pour une dernière représentation. La communauté tissée serrée fera son petit tour de piste comme les autres l’ont fait, avec les mêmes courbettes, mimant les mêmes conventions, respectueuse des mêmes étiquettes balisées par les mêmes traditions. Mais ce sera un dernier tour de piste. Une dernière représentation, un chant du cygne.
Le chant du cygne répété à chacun des fleurons de cette époque fut magnanime et grandiose, tout comme l’époque l’avait été.
Le recrutement embauchait une abondante relève, les maisons de formation opéraient à plein et avaient même allongé le temps de préparation des sujets, des bulles de communautés bien scellées étaient semées à tout vent et portaient à des sols variés des semences prometteuses. Les chroniques de La Voix débordaient de vitalité et ses tableaux d’honneur affichaient d’éclatants palmarès. Et pendant ces années aussi, le rayonnement des missionnaires couvrait toute la planète. Quelques provinces pourtant jeunes, se scinderont encore et on mettra encore en chantier quelques maisons de formation, mais ce seront les dernières.
Si éclatant que soit un chant du cygne il laisse souvent vibrer de tristes harmoniques. Celles qui annoncent la tombée du rideau. On a alors le sentiment, ou l’on constate assez rapidement, que les expériences minutieusement acquises ne serviront plus, les formules de recrutement qui assuraient une riche et dynamique relève ne produiront plus, les tableaux d’honneurs n’afficheront plus de conquêtes ni d’exploits et les airs de fête ne résonneront plus dans ces murs si fréquemment ornés de banderoles. On devra même rayer des noms fort applaudis aux prestigieux temples de la renommée communautaire. Ce dernier tour de piste brillant comme un éclair ne dura que quelques années, à peine une décennie.

Les trois ans que je passerai à Rome, de 1958 à 1961 seront pour moi comme le « no man’s land » entre le passé et ce qui viendra, le trait d’union entre deux époques qui se suivent, l’une bien définie mais révolue, l’autre informe, embryonnaire et vaporeuse mais qui occupera vite tous les devants de la scène et tout le temps de l’univers occidental.
Pourquoi faut-il mourir pour renaître? Pourquoi le vin nouveau ne peut-il remplir les vieilles outres?
J’aurai trois ans pour revoir et réajuster ma place dans un monde en mouvement. J’étais alors, sans le savoir, un funambule en équilibre instable sur une corde raide tendue entre ces deux mondes.
D'autres photos de Chertsey.
 Qu’y a-t-il après le chant du cygne?
Qu’y a-t-il après le chant du cygne?


 L
L Temps de légende
Temps de légende